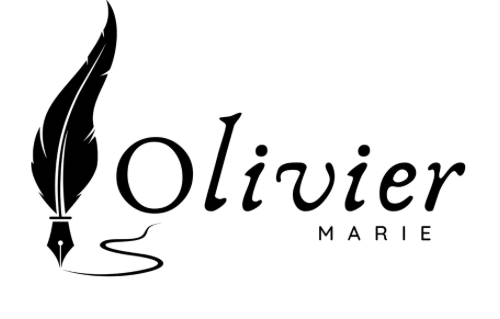L’épistémocritique est une manière de lire la littérature en s’intéressant à ses liens avec les savoirs. Elle ne cherche pas seulement à repérer des influences ou à vérifier si un écrivain a bien utilisé les sciences de son temps, mais à comprendre comment la littérature transforme ces savoirs, les réinvente et en propose une autre lecture. Les romans, les nouvelles ou les poèmes ne sont donc pas de simples reflets de la science ou de l’histoire : ils deviennent des lieux où s’élabore une pensée originale, qui dialogue avec les savoirs établis, les critique parfois, et les rend sensibles à travers la fiction. Appliquée à un recueil comme Destins confisqués, cette approche permet de voir comment chaque nouvelle ne se contente pas de raconter une histoire singulière mais met en jeu des savoirs multiples, historiques, sociologiques, anthropologiques ou psychologiques, que la fiction transforme et rend vivants. Loin d’être de simples portraits romanesques, ces récits deviennent ainsi des laboratoires où s’élaborent d’autres manières de comprendre l’Histoire et l’expérience humaine. Dans ce recueil en effet les personnages, pris dans les filets de l’Histoire, incarnent des points de rencontre entre mémoire individuelle et archives collectives, entre anthropologie des marges et historiographie dominante.
Le premier registre de savoir mobilisé est celui de l’histoire. Les figures convoquées, qu’il s’agisse de William Patrick Hitler, neveu embarrassant du Führer, de Beate Uhse, aviatrice devenue pionnière de l’industrie érotique dans l’Allemagne d’après-guerre, ou encore de Tsutomu Yamaguchi, survivant des deux bombardements atomiques, s’enracinent dans des épisodes historiques parfaitement attestés. Cependant, le recueil ne se contente pas d’en restituer les contours documentés, il opère une véritable transmutation narrative qui transforme ces fragments d’histoire en expériences de pensée sur la contingence, la fatalité et la puissance des idéologies. La littérature y devient non seulement récit mais instrument critique, qui révèle ce que les archives officielles tendent à dissimuler : la discontinuité, l’ambivalence, le hasard.
Le deuxième registre est celui de l’anthropologie. En s’attachant aux destins individuels, souvent relégués aux marges ou effacés par les récits dominants, l’auteur adopte une démarche proche de l’ethnographie des vies minuscules. Chaque nouvelle, par sa construction patiente et ses détails incarnés, restitue une culture, un réseau de représentations, un système de valeurs. L’anthropologue des sociétés traditionnelles comme l’historien des subalternes se retrouveraient dans cette méthode, où la singularité des parcours devient un révélateur des structures sociales invisibles. L’épistémocritique permet alors de souligner que la littérature ici n’est pas seulement mémoire, elle est fabrique de savoir anthropologique.
Le troisième registre convoqué est celui de la sociologie critique, au sens de Bourdieu ou d’Elias. Les personnages évoluent ainsi dans des contextes où plusieurs formes de domination se croisent et se renforcent. Saïd Mohammedi, pris dans la double emprise de la colonisation française en Algérie et de l’occupation allemande en Europe, incarne cette tension : il navigue entre l’armée coloniale, l’appareil nazi et, plus tard, la lutte indépendantiste, révélant les contradictions d’un parcours façonné par des puissances étrangères antagonistes. John Ward, scout séminole noir engagé dans l’armée américaine, subit quant à lui une domination raciale interne, héritée d’un double esclavage, en même temps qu’il participe à l’expansion militaire des États-Unis contre d’autres peuples opprimés. Ces deux trajectoires montrent comment la littérature permet de mettre en lumière la complexité des destins pris dans l’entrecroisement des dominations coloniales, raciales et impériales, d’autres figures plus contemporaines subissent domination économique et médiatique, domination symbolique dans des destins pris entre honte et célébrité. La fiction dévoile ce que l’analyse sociologique énonce sous forme de schèmes théoriques, mais elle le donne à voir et à sentir dans la chair des existences. La littérature y prolonge le savoir sociologique en lui restituant la densité de l’expérience vécue.
Enfin, un registre éthique et psychologique traverse l’ensemble du recueil. Les dilemmes moraux, la culpabilité, la mémoire transgénérationnelle constituent autant de thèmes qui relèvent d’une anthropologie des passions. Ici encore, la littérature n’illustre pas un savoir déjà constitué, elle invente des formes sensibles pour dire ce que la psychologie ou la psychanalyse traduisent autrement : le poids de l’inconscient collectif, les contradictions entre rôle social et subjectivité, la fragilité des identités construites dans la violence de l’histoire. De ce point de vue, Destins confisqués ne se limite pas à la reconstitution à peine romancée de trajectoires singulières, il s’agit d’un espace où les savoirs historiques, anthropologiques, sociologiques et psychologiques se croisent, se contaminent, se déplacent. Le recueil devient alors un véritable opérateur épistémocritique : il montre comment la littérature, loin de dépendre passivement des sciences humaines, les prolonge, les déplace et parfois les contredit, en élaborant une connaissance sensible et critique du monde.