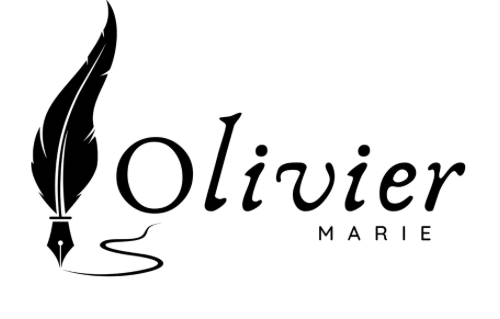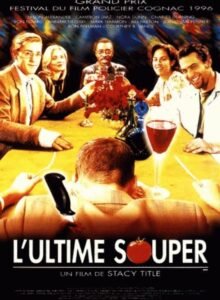
Le danger réside-t-il vraiment dans les discours extrêmes eux-mêmes ou réside-t-il plutôt dans le refus de les affronter à armes égales, dans cette volonté de les contenir par le mépris plutôt que de les déconstruire dans le cadre d’un débat assumé ? C’est ce débat qu’illustre avec une acuité remarquable le film Le Dernier Souper (The Last Supper), de Stacy Title, sorti en 1995, que l’on pourrait croire caricatural si la réalité politique contemporaine ne lui donnait pas chaque jour un peu plus raison. Il arrive ainsi parfois que la fiction cinématographique, lorsqu’elle ne cède pas aux effets convenus du divertissement ou aux prêches idéologiques, révèle avec une acuité troublante les impensés de nos régimes politiques prétendument rationnels. Ainsi en va-t-il de ce Dernier Souper, dans lequel une communauté de jeunes intellectuels progressistes, pétris de bonnes intentions mais gangrenés par une rectitude morale intransigeante, organise des dîners au cours desquels ils empoisonnent leurs invités, tous porteurs d’opinions jugées insoutenables. Le postulat, déjà glaçant, bascule dans l’ironie noire lorsqu’un extrémiste populiste, incarné par Ron Perlman, retourne leur mise en accusation en une démonstration rigoureuse de la vacuité démocratique dès lors qu’elle refuse d’assumer ses tensions internes. Ce personnage, loin d’incarner la caricature attendue du fanatique, déploie un raisonnement implacable : la démocratie, si elle prétend garantir la liberté d’opinion, ne peut se permettre de trier parmi les voix, de hiérarchiser les paroles recevables et de reléguer au silence celles qui dérangent l’orthodoxie dominante. Ce n’est pas dans le confort du consensus que se forge la vitalité politique, mais dans le tumulte du dissensus. C’est au contact des extrêmes, précisément parce qu’ils déplacent les lignes de partage du pensable et du dicible, que les idées se confrontent, se reforment ou s’écroulent. Supprimer ces voix au nom de l’harmonie, c’est substituer à la démocratie réelle une liturgie molle, un simulacre de pluralisme réduit à l’entre-soi d’un camp du Bien convaincu de sa propre supériorité morale. Loin de se contenter d’une leçon rhétorique, le film donne à voir un phénomène plus grave, et trop rarement interrogé : celui d’une société qui, à force de traquer l’outrance au nom de la vertu, finit par engendrer les monstres mêmes qu’elle prétend conjurer, car l’exclusion des discours dissidents, loin de les annihiler, les sacralise. À l’ère de la communication virale, le silence imposé devient caisse de résonance, la censure se mue en stratégie de légitimation, et l’interdiction d’expression en brevet de vérité. Plus une idée est proscrite, plus elle attire l’attention ; plus un discours est diabolisé, plus il bénéficie de l’aura sulfureuse de la dissidence ; plus une parole est frappée d’anathème, plus elle devient, aux yeux de certains, le lieu d’une authenticité perdue. Cette mécanique, que les sciences politiques ont pourtant décrite depuis longtemps, se voit rarement reconnue par les gardiens du débat public. Pierre-Henri Tavoillot l’a énoncé avec sobriété : « la démocratie, c’est le conflit civilisé ». Encore faut-il accepter que le conflit soit possible, que l’antagonisme n’est pas une pathologie du politique mais sa condition d’existence. Hannah Arendt l’avait déjà perçu, dans une langue plus pénétrante encore, lorsqu’elle affirmait que l’espace politique ne peut advenir que dans la pluralité irréductible des opinions, et que toute tentative d’unification idéologique confine à l’effondrement du monde commun. L’unanimisme n’est pas un idéal démocratique, mais un précipité totalitaire. Dans cette perspective, la tyrannie morale, qui se prétend prophylaxie contre les extrêmes, s’avère en réalité leur matrice, l’indignation vertueuse, lorsqu’elle se fige en norme, produit l’inverse de ce qu’elle prétend défendre : elle fabrique du ressentiment, elle exile la parole critique, elle donne aux factions les plus radicales le monopole de la transgression. Ceux que l’on croyait réduire au silence deviennent les seuls à incarner, aux yeux d’un nombre croissant, le courage de nommer ce que l’on ne dit plus, le droit de déranger un ordre du discours verrouillé par l’entre-soi universitaire, médiatique ou militant. Ce phénomène, observable à l’échelle de tous les régimes libéraux contemporains, constitue l’un des points de bascule majeurs de la démocratie actuelle : en renonçant à affronter les idées, on les refoule ; en prétendant les neutraliser, on les renforce. Le débat est remplacé par le soupçon, l’échange par la stigmatisation, la contradiction par l’excommunication. L’orthodoxie progressiste devient l’alibi d’un nouvel autoritarisme, dont la force réside précisément dans sa bonne conscience. Dès lors, l’extrémiste ne se reconnaît plus à son discours, mais à sa simple existence médiatique. Il n’a même plus besoin de choquer pour exister : il lui suffit d’être exclu pour apparaître, le bannissement devient pour lui une forme de publicité, le silence, une stratégie de conquête, et le refus des adversaires de dialoguer, un acte de capitulation, et ceux là mêmes qui prétendaient protéger la démocratie, en triant parmi ses voix, se retrouvent alors dépossédés de leur propre autorité. En cela, The Last Supper n’est pas seulement une fable cruelle sur les dérives d’un progressisme devenu justicier ; c’est une métaphore pénétrante de notre époque, où la démocratie ne meurt pas par excès de chaos, mais par excès d’ordre. Ce ne sont plus les extrêmes qui la détruisent de l’extérieur : ce sont les zélateurs du Bien qui, à force de vouloir la purifier, l’évident de sa substance conflictuelle. La leçon d’Hannah Arendt est oubliée, le pluralisme devient un slogan sans pluralité, l’opinion dissidente, une hérésie, et la liberté, un mot vide, trop pur pour être vécu.